-
Vient de paraître
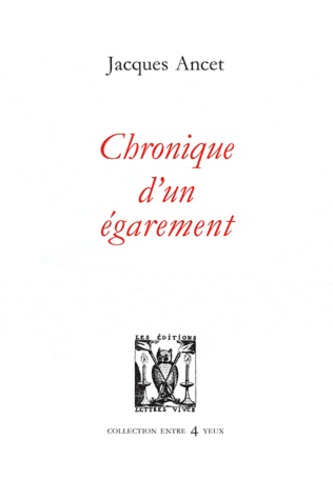
Je suis perdu. Tout va bien. Il fait une journée magnifique. Les champs sont en herbe, le ciel plus près de la terre, mais je suis perdu.
Est-ce l’âge ? Ce sentiment d’être partout à côté. Ou alors ici, mais totalement. Si bien que les choses me submergent.
J’essaie de résister : entretenir la vie, répondre au téléphone, faire bonne figure. Parfois, c’est comme un éclat : j’y suis vraiment, je ris, les autres se rapprochent.
Aujourd’hui est un jour comme un autre.
Ou peut-être non, à cause de l’été précoce. Globalement, pas de raisons de se réjouir (petits malaises, grèves, guerres, massacres), mais le matin ressemble à l’enfance. Aux matins de l’enfance, je veux dire. Avec cette légèreté du ciel plus vif dans les arbres ou près du rouge des géraniums entrevus à une fenêtre d’un dernier étage. La fenêtre était ouverte. J’ai pensé que toute une histoire pourrait s’écrire à partir de cette seule fenêtre ouverte. Ce qui se passerait dedans, dans l’obscur de l’encadrement. Aucun drame. La vie, simplement, avec ses hauts et ses bas. Ce qu’on ne peut jamais dire…
Décidément, je suis perdu. Je vais, je viens. Je voyage, je dors. J’aime la lumière du matin. C’est comme une porte entrebâillée : elle va s’ouvrir, je le sais. Mais elle ne s’ouvre pas. Ou si peu. Alors je regarde par l’embrasure. Je vois une sorte de clair, avec des yeux. Une rue aussi, une silhouette qui s’approche. Elle tient un enfant par la main. Elle passe sans me regarder.
Pourquoi s’obstiner ? Jardin, maison, campagne, ville ressassent leurs couplets. Je les entends, je les écoute même. Je les reprends avec eux. Et soudain c’est comme si tout m’abandonnait. Je balbutie, je me tais. L’amour lui-même m’égare un peu plus.
–– C’est toi ?
–– C’est moi.
Ma main se tend. Comme si elle quittait mon corps. Je la vois toucher la tienne, mais comment la rattraper ? Le jour va trop vite –– et la nuit. Même quand j’y suis, il est trop tard.
L’été vient de face comme un insoutenable regard. Dans le chêne, des morceaux de bleu qui bougent. Ou les feuilles, les yeux, comment savoir puisque tout se tient. On fume. On parle. Ce que je veux dire je ne le dis pas. Autre chose, toujours. Ces menus riens, mouches, pailles ou cris d’enfants. Et l’attente, là, quelque part entre gorge et ventre –– une sorte de vide que rien ne remplit, ni l’ombre, ni la lumière, ni les paroles, ni leur envers. Si je marche, quelqu’un marche avec moi, un peu en avant, il m’oblige à le suivre, à courir parfois. Si je dors, il traverse mon sommeil. Je crois savoir : erreur : je ne sais pas puisqu’il se réveille avant moi, brouille chacune de mes pensées, éclate de rire quand je suis sombre, me ferme la bouche quand je crie. Alors, comment ne pas être perdu même au milieu d’un jour sans histoire : lumière, silence et ciel trop bleu ? L’histoire, on le sait bien, est ailleurs. Pas là où l’on croit, en tout cas. Très loin, tout près, cancer invisible qu’on détecte toujours trop tard. D’un jour sur l’autre un avion ne cesse de passer comme si tout s’était arrêté ; gestes, ombres sur le sol, feuilles agitées par le vent, mouche et, sur l’écran l’interminable vertige d’une image sans futur. Tags : Ancet Jacques
Tags : Ancet Jacques
-
Commentaires
le blog de Jacques Ancet

Ces textes sont d'un beau livre, et d'un poète profond. Ils m'ont plu, je tâcherai de trouver le livre (je ne me procure rien sur internet !)