-
Par Tecna1 le 25 Août 2011 à 21:45
Vient de paraître
Jacques Ancet & Aaron Clarke,
Lumière mortelle,
éd. centrifuges, 2011,
20 exemplaires numérotés et signés par l'auteur et l'artiste (à commander pour 60 euros à Armand Dupuy, La Ville 69470)

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Tecna1 le 6 Juin 2011 à 11:06

Jacques Ancet
ou la voix traverséecollectif d'auteurs
Sous la direction de Sandrine Bédouret-Larraburu et Jean-Yves Pouilloux
"Personne ne sait. Ni l’ombre entrée sans qu’on l’ait vue, ni la voix qui s’obstine à épeler le jour. Le silence à présent est trop lourd à porter. Les yeux cherchent, ne trouvent que leur vide."Personne ne sait. » Jacques Ancet né en 1942 est poète (en vers et en proses), traducteur de l’espagnol et essayiste. Son œuvre abondante est reconnue et essentielle. L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a organisé des rencontres en 2009 et, en octobre 2010, un colloque de travail et d’échange en présence de Jacques Ancet est venu parachever les liens tissés.
Si le sérieux des études ici rassemblées répond à l’exigence de l’œuvre, l’amitié traverse aussi ces gestes critiques chaque fois singuliers. Chacun ici s’essaie à résonner des multiples échos d’une voix traversée par l’appel de l’imperceptible que l’œuvre de Jacques Ancet nous fait écouter au plus près. Merci aux deux organisateurs de cet ensemble, merci à Jacques Ancet pour les inédits qui l’ouvrent.
S. Martin
Collection : Résonance Générale : Essais pour la poétique Genre : Essais Date de parution : 2011-05-26 Nombre de pages : 216
Format (cm) : 13,5x21.5 Prix : 20 euros ISBN : 978-2-911648-45-8 Soutiens : Ouvrage publié avec le soutien du CRPHL de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, du Conseil Régional Aquitaine, du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et de la Communauté des Communes Pau-Pyrénées.
L'Atelier du Grand Tétras
Au-Dessus du Village - 25210 Mont de Laval tél - fax : 03 81 68 91 91 adresse électronique : latelierdugrandtetras@gmail.com site internet : http://www.latelierdugrandtetras.fr/ votre commentaire
votre commentaire
-
Par Tecna1 le 19 Mai 2011 à 12:31
JUAN GELMAN
Lettre ouverte suivi de Sous la pluie étrangère
édition bilingue
présenté et traduit de l'argentin parjacques ancet
Editions CARACTÈRES
Cahiers latins
Juan Gelman est né à Buenos Aires en 1930. Poète, traducteur, journaliste, militant révolutionnaire, il quitte l’Argentine en 1975, un peu avant que ne s’installe dans le pays, de 1976 à 1982, l’une des pires dictatures qu’ait connue l’Amérique Latine en ce siècle pourtant fertile en horreurs et atrocités. Les militaires argentins séquestreront ses deux enfants et sa belle-fille enceinte. Miraculeusement, sa fille Nora Eva échappera à la mort. Son fils, ne reparaîtra pas. Il faudra attendre le 21 décembre 1989 pour que des médecins légistes identifient les restes de Marcelo Ariel dont le corps, jeté dans le canal de San Fernando, avait été découvert dans un baril contenant ciment, graisse et fer. L’enterrement aura lieu le 7 janvier 1990. Il faudra attendre encore plus longtemps, c’est-à-dire 1999, pour que Juan Gelman finisse par retrouver sa petite fille âgée de vingt-trois ans, née en prison, enlevée à sa mère et, comme c’était courant alors, clandestinement “adoptée” en toute impunité par les familles des militaires ou de leurs proches et donc coupée de toutes ses racines. Quand on demande à Juan Gelman s’il peut pardonner, après l’exil et la disparition des siens, il répond : « Non, je ne crois pas au pardon. Pour une raison très simple ; je ne sais pas à qui les victimes ont délégué leur faculté de pardonner. Je ne peux m’arroger cette faculté. Je crois en la justice. »
Lettre ouverte, écrit en janvier 1980, est sans doute le texte le plus extrême de Juan Gelman. Peut-être parce que, dans un bouleversement affectif et langagier qui, à ma connaissance, n’a pas d’équivalent dans la poésie contemporaine, s’y exprime l’extrême du désarroi et de la souffrance — au sens propre : une passion. Celle du père crucifié par la disparition du fils qui ne trouve plus pour dire l’absence et la douleur que l’éclatement d’une écriture rendue plus explosive encore par le recours à une forme et une métrique régulières : le quatrain et le grand vers classique hispanique : l’hendécasyllabe.
Sous la pluie étrangère composé en mai 1980, est l’autre face de ce diptyque. Après les poèmes de Lettres ouverte écrits dans une sorte d’apnée du sens, l’écriture plus directe, plus narrative et même autobiographique de ce recueil (les parents, la vie quotidienne à Rome ou à Paris, le retour clandestin à Buenos Aires, le fils disparu, les amis perdus...) permet de voir l’autre face de la tragédie : sa face grise, celle de l’exil qui en est à la fois la cause et la conséquence.
Ces deux recueils forment donc bien un diptyque, et c’est comme tels qu’on les présente ici. Pour que ce grand poète qu’est Juan Gelman nous soit un peu mieux révélé dans toute sa stature : celle d’un homme qui, face aux atrocités et aux désespoirs de la vie a su résister non pas par la haine, la rancœur ou la soif de vengeance, mais par l’amour, la beauté, l’enfance. Et par la poésie qui les réunis tous. Une poésie qui, dans le bouleversement et l’intensité qui sont les siens, est un acte de vie interminablement jeté à la face de la mort.LETTRE OUVERTE
VI
corps qui me trembles tout entré dans l’âme/
froid qui me fait froid/petite main tienne
fontaine d’ombre/d’ombre/d’ombre/d’ombre
quelque part j’arrête ta destruction ?/
je te rejoins ?/attriste ta parole ?/
fais souffrir ton jamais ?/plus ?/jamais plus
pour moi regard de beauté ta beauté ?/
es-tu repos de ta peau ?/un très grand
dévouloir ?/m’écoutes-tu suspendant
ton passage hors de toi?/frimousse qui
illumine ton animal/ou peine ?/
vient traverser mon ciel/ comme soleil ?/
VII
te désenfantant/me désenfantant/
te poursuivant dans ta suavité/
j’endure d’être père seul de toi/passe
la voix secrète que patient/tu tisses/
tel désâmement de mon existence/
tout petit qui volant passes à travers
les souffrances tout extrêmes de toi?/
liant ?/déliant ?/liant pour que je
n’habite pas en toi ?/m’en aille loin
de cette douleur ?/mais où ?/quel pays
saignes-tu/ afin que chairment je saigne?/
où passes-tu ?/si triste d’être tiède ?
VIII
voles-tu hors mère en ton réconfort ?/
des ombres adoucissent ton tant mourir ?/
es-tu déjà coupé de tout ce qui
tirait ta douce âme en arrière comme
bonheur dans la main ?/chauffes-tu la nuit ?/
parles-tu sur les murs de la douleur
contre le mal ? / te dresses-tu fils ? / braise ?/
brûles-tu la nuit du bourreau ?/ es-tu ?/
cognes-tu de ton souffrir/désaimé
dissémines-tu ton feu/chaleur/tendre/
qui te donnait des sanglots d’aimer
au pied de ton tout seul ? ton compagnon ?
IX
là comme pas là ?/vie que tu médites ?/
comme un autre monde ?/aimant humblement ?/
signales-tu tes passages par l’oubli ?/
arbrerais-tu tes tout petits désarbres
rien que pour ombrager ma rêverie
qui sue au feu de tes absences ?/quand ?/
m’assieds-tu à la table de ton âme ?/
me décheminerais-tu afin d’être
chemin où tu passerais comme enfant
que tu désenfantes en douleurs ?/revers
de lumière où tu te taisais beaucoup ?/
comme un chant qui tombe d’une soleil ?
X
la souffrance/est-elle défaite ou bataille ?/
réalité qui broies/es-tu compagne?
tant de perfection te sauve de quoi?/
ne te fais-je pas mal ?/ne te juané-je ?/
te gelmané-je ?/ ne te chevauché-je
comme fou de toi ?/tien poulain qui passe
dévalorisant la mort malheureuse ?/
celle qui pleure au pied de mes mouroirs?/
ne suis-je pas là pour te paterner?/
vas-tu m’excuser de tant te filier ?/
réel que tu subis comme accouchant/
ton souffroir/chante-t-il pour/contre moi ?/
me révèles-tu ce que je peux être ?/
m’ailes-tu/toi aile de ma fureur ?/
te dé-pouponnes-tu comme colombe
qui recherche un œil aveugle pour voir ?SOUS LA PLUIE ÉTRANGÈRE
III
Je ne vais pas avoir honte de mes tristesses, de mes nostalgies. Je regrette la petite rue où on a tué mon chien, et j’ai pleuré près de sa mort, et je suis collé au pavé sanglant où mon chien est mort, j’existe toujours à partir de ça, j’existe de ça, je suis ça, je ne demanderai la permission à personne d’avoir la nostalgie de ça.
Suis-je autre chose, peut-être ? Des dictatures militaires sont venues, des gouvernements civils et de nouvelles dictatures militaires, ils m’ont privé de mes livres, de mon pain, de mon fils, ils ont fait le désespoir de ma mère, ils m’ont chassé de mon pays, ils ont assassiné mes petits frères, mes camarades ils les ont torturés, déchiquetés, brisés. Personne ne m’a chassé de la rue où je pleure à côté de mon chien. Quelle dictature militaire pourrait le faire ? Et quel militaire fils de pute m’arrachera au grand amour de ces crépuscules de mai, où l’oiseau de l’être se balance face à la nuit ?
Mon pays n’était pas parfait avant le putsch militaire. Mais il était mon lieu, les jours où j’ai tremblé contre les murs de l’amour, les jours où j’ai été enfant, chien, homme, les jours où j’ai aimé, on m’a aimé. Aucun général ne va rien arracher de tout ça au pays, à la douce terre que j’ai arrosée avec peu ou beaucoup d’amour, cette terre que je regrette tant et qui tant me regrette, cette terre que rien de militaire ne pourra me salir ou salir.
Il est juste que je la regrette. Car nous nous sommes toujours aimés comme ça : elle réclamant plus de moi et moi d’elle, tous deux meurtris par la douleur que l’un causait à l’autre, et forts de l’amour que nous nous portons.
Je t’aime, patrie, et tu m’aimes. Dans cet amour nous consumons imperfections et vies. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Tecna1 le 15 Avril 2011 à 11:48
VIENT DE PARAîTRE
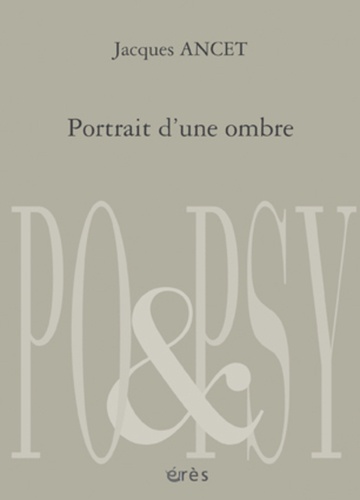
Il brille. Ou plus exactement, il miroite. On ne voit pas, on entrevoit, on ne voit pas. Une lueur, une presque voix. On est là au même endroit avec le chêne et la clôture, la montagne et le ciel. Très vite, on n’y est pas — on y est. Il dit ... On va comprendre. La lumière bouge. Le vent tombe. On va le voir.
— On voit, oui. Mais quoi ?
— Ce qu’on entend.
— Comment ça ?
— Des images dans l’oreille.
— Dans l’oreille ?
— Oui, là où parle la voix.
— Et que dit-elle ?
— Ce qu’on voit.
Sous la montagne, l'attraction de la nuit. Des racines sous l’arbre. Du vide sous l’espace. Sous les choses une force qui les rapproche, les serre. Un continu sans failles qui se referme. Et soudain, un souffle, une lueur, un rire. Ce pourrait être lui.
— On n’entend rien.
— C’est ce rien qui entend.
— Trop facile
— Trop difficile.
— Pourquoi ne pas se taire ?
— Se taire dit trop.
Il bouge dans ce qui bouge. Dans ce qui est immobile. Dans les feuillages balancés, dans le vert du pré. Dans l’éblouissement jaune du couchant. Dans les lunettes et dans la main, il passe, ne s’arrête pas. On a cru percevoir une ombre, mais c’est tout aussi bien une lueur ou même rien de ce qu’on peut dire. Mais c’est là. On s’arrête, on guette. Voilà la nuit dit une voix. On ne voit rien.
Longtemps on a cru que c’était une ombre mais à une ombre il faut un corps. Un monde aussi. Des pierres, des feuilles rouges, des rires, un saxo. Quelques pas, un éclat brusque, vitre ou visage. Un rien qui insiste, qui perce. On compte : un, deux, trois. Á quatre on a perdu. On dit : trop tard. On reste au bord.
— Au bord ?
— Au bord.
— De quoi ?
— Au bord, au bord.
On dit qu’il bouge, façon de parler - ou qu’il rit. Qu’il vient ou s’en va. Mais non. Il est là, simplement, il se cherche. Il entre dans le regard, la voix. On ne le voit pas. On ne le sent pas. Un instant on est lui. On saute par-dessus la clôture, on court. On lève les bras pour porter le ciel. On s’écroule. On n’est plus que soi.
C’est comme un sommeil. les yeux se ferment et on voit. Ça danse, ça gesticule. Une gerbe de couleurs, un rire en grelots.
— Écoute
— Oui ?
— Tu entends ?
— Oui.
— Il est là.
— Oui.
Une ombre sur les yeux ouverts.
Il a tous les visages. Il va et vient dans des couloirs, métros, gares, aéroports. Il passe des portes vitrées, feuillette des revues, rit au téléphone. Parfois, il disparaît sans crier gare. On croit voir sa forme dans la foule, son vide phosphorescent. On court. On crie. On fait hep ! hé ! On dit, mais où t’es-tu caché ? Dans les toilettes l’eau coule toujours du robinet, le séchoir souffle encore son air chaud. On se regarde dans le miroir désert.
On se dit que tous les jours on l’a perdu, que la brume et le temps l’ont effacé. Que le brouhaha a recouvert sa voix. Qu’il ne reste rien de son rire et sa pluie d’éclats étincelants. On se dit que c’est trop tard, toujours trop tard. La lumière laisse ses ombres et s’en va. On s’en va aussi, on ne sait plus où. Toutes les destinations reviennent à la pente étroite du même escalator noir. C’est là, au moment de descendre qu’on le voit monter. On se croise. Son visage est obscur, mais il sourit. Il montre du doigt quelque chose plus haut. Mais on descend, on s’enfonce. Quand on se retourne, on ne voit plus, au-dessus, que la bouche de lumière où il disparaît. 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Tecna1 le 25 Février 2011 à 22:59
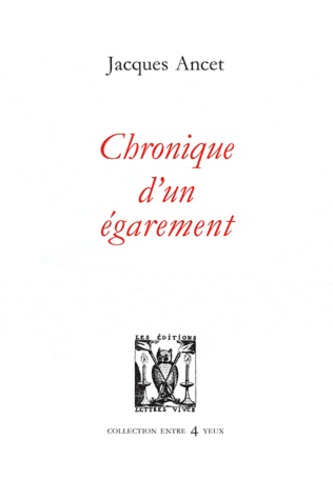
Je suis perdu. Tout va bien. Il fait une journée magnifique. Les champs sont en herbe, le ciel plus près de la terre, mais je suis perdu.
Est-ce l’âge ? Ce sentiment d’être partout à côté. Ou alors ici, mais totalement. Si bien que les choses me submergent.
J’essaie de résister : entretenir la vie, répondre au téléphone, faire bonne figure. Parfois, c’est comme un éclat : j’y suis vraiment, je ris, les autres se rapprochent.
Aujourd’hui est un jour comme un autre.
Ou peut-être non, à cause de l’été précoce. Globalement, pas de raisons de se réjouir (petits malaises, grèves, guerres, massacres), mais le matin ressemble à l’enfance. Aux matins de l’enfance, je veux dire. Avec cette légèreté du ciel plus vif dans les arbres ou près du rouge des géraniums entrevus à une fenêtre d’un dernier étage. La fenêtre était ouverte. J’ai pensé que toute une histoire pourrait s’écrire à partir de cette seule fenêtre ouverte. Ce qui se passerait dedans, dans l’obscur de l’encadrement. Aucun drame. La vie, simplement, avec ses hauts et ses bas. Ce qu’on ne peut jamais dire…
Décidément, je suis perdu. Je vais, je viens. Je voyage, je dors. J’aime la lumière du matin. C’est comme une porte entrebâillée : elle va s’ouvrir, je le sais. Mais elle ne s’ouvre pas. Ou si peu. Alors je regarde par l’embrasure. Je vois une sorte de clair, avec des yeux. Une rue aussi, une silhouette qui s’approche. Elle tient un enfant par la main. Elle passe sans me regarder.
Pourquoi s’obstiner ? Jardin, maison, campagne, ville ressassent leurs couplets. Je les entends, je les écoute même. Je les reprends avec eux. Et soudain c’est comme si tout m’abandonnait. Je balbutie, je me tais. L’amour lui-même m’égare un peu plus.
–– C’est toi ?
–– C’est moi.
Ma main se tend. Comme si elle quittait mon corps. Je la vois toucher la tienne, mais comment la rattraper ? Le jour va trop vite –– et la nuit. Même quand j’y suis, il est trop tard.
L’été vient de face comme un insoutenable regard. Dans le chêne, des morceaux de bleu qui bougent. Ou les feuilles, les yeux, comment savoir puisque tout se tient. On fume. On parle. Ce que je veux dire je ne le dis pas. Autre chose, toujours. Ces menus riens, mouches, pailles ou cris d’enfants. Et l’attente, là, quelque part entre gorge et ventre –– une sorte de vide que rien ne remplit, ni l’ombre, ni la lumière, ni les paroles, ni leur envers. Si je marche, quelqu’un marche avec moi, un peu en avant, il m’oblige à le suivre, à courir parfois. Si je dors, il traverse mon sommeil. Je crois savoir : erreur : je ne sais pas puisqu’il se réveille avant moi, brouille chacune de mes pensées, éclate de rire quand je suis sombre, me ferme la bouche quand je crie. Alors, comment ne pas être perdu même au milieu d’un jour sans histoire : lumière, silence et ciel trop bleu ? L’histoire, on le sait bien, est ailleurs. Pas là où l’on croit, en tout cas. Très loin, tout près, cancer invisible qu’on détecte toujours trop tard. D’un jour sur l’autre un avion ne cesse de passer comme si tout s’était arrêté ; gestes, ombres sur le sol, feuilles agitées par le vent, mouche et, sur l’écran l’interminable vertige d’une image sans futur. 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
le blog de Jacques Ancet




